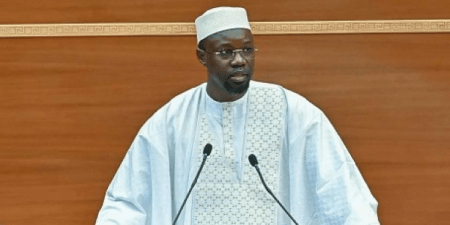Les embarcations qui transportent les candidats à ces migrations irrégulières, jusqu’en Espagne, sont le fait des acteurs de la pêche : leurs pirogues, les capitaines qui deviennent convoyeurs. En effet, aujourd’hui, nombreux sont les pêcheurs expérimentés qui ont rompu les rangs pour piloter ces pirogues à destination des îles espagnols. Macoumba Dièye, président de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPARS) confirme.
«Dans le passé, sur un effectif de 100 candidats de ces voyages périlleux, vers l’Espagne, l’on comptait que 6 pêcheurs, aujourd’hui, c’est tout le contraire. Parce que pour chaque embarcation en direction des îles espagnoles, l’on dénombre près de 80 pêcheurs à bord. A titre d’exemple, la pirogue de Fass Boye retrouvée au Cap-Vert, était remplie de pêcheurs alors que 80 clients qui avaient versé leur argent, ont été laissés à terre. C’est dire que les jeunes pêcheurs font, aujourd’hui, face à d’innombrables problèmes. Et la principale cause c’est la raréfaction des produits halieutiques. Mais c’est une situation qui peut être encore rectifiée par les autorités», renseigna-t-il.
Parlant de ces capitaines conduisant les migrants clandestins vers l’Espagne, nombreux sont ceux d’entre eux qui revenaient au bercail pour continuer leurs activités de pêche. Mais, à l’époque, le poisson était abondant. L
es pêcheurs tiraient leur épingle du jeu. A Saint-Louis, durant les ‘’campagnes’’ de pêche qui duraient 6 mois, les propriétaires de pirogues employaient entre 40 et 50 pêcheurs dans chaque embarcation pour les «fils à tourner», «chaines tournantes». Chacun, à la fin de ces campagnes gagnait entre 800 000 et 3 millions de nos francs», se remémore Macoumba Dièye, le président de l’UNAPARS.
Le prix d’un panier de Yaboye passe entre 2012 et aujourd’hui, de 3 000 FCFA à 100 000 FCFA
«À cette époque, la mer était poissonneuse», se répète-t-il. Telle n’est plus le cas aujourd’hui, signale-t-il, avec regret.
La preuve, «lors de la dernière campagne, seules 3 pirogues sur près de 500 ont pu payer à chaque pêcheur embarqué quelque 2 millions, à Saint-Louis. Tout le reste des propriétaires de pirogues a fini à la gendarmerie parce qu’ils n’ont pas eu assez de ressources pour payer les pêcheurs qui étaient engagés pendant 6 mois de campagne à cause des dettes. Et pour chaque pirogue, il faut compter pas moins de 50 personnes sans parler de ceux qui travaillaient à terre. A Saint-Louis, les risques auxquels sont confrontés les pêcheurs face à la brèche au quotidien, pour les pêcheurs, ont été aussi un motif pour eux de grossir les flux migratoires».
Pour le président de l’UNAPARS, la solution contre ces embarcations se trouve dans une gestion concertée des accords de pêche. «La rareté des ressources halieutiques est un des facteurs qui favorisent ces migrations irrégulières. Si l’Etat veut freiner cette forte ruée vers les îles espagnoles, il lui faut revoir les accords de pêche et voir comment faire pour les éliminer ou les réduire drastiquement».
A l’en croire, les acteurs de la pêche avaient sonné l’alerte sur les éventuelles conséquences de cette rareté de produits halieutiques. «Nous avions lancé l’alerte depuis longtemps. L’État aurait dû prendre les devants et nous éviter d’en arriver là. Nous avions rencontré les autorités et leur avions remis un mémorandum de 25 points, contenant les soucis relevés et leurs solutions préconisées».
«Sur un effectif de 100 candidats de ces voyages périlleux, l’on dénombre près de 80 pêcheurs à bord»
La situation allant de mal en pis, Macoumba Dièye pense que l’État dispose des moyens pour mettre «un frein à cette migration irrégulière dans les meilleurs délais. Il lui faut juste impliquer l’UNAPARS. Aujourd’hui, quasiment tous les pêcheurs sont regroupés autour de 90 groupes WhatsApp avec près de 1000 membres chacun, au niveau national et dans la diaspora. Des pêcheurs partis en Espagne, via ces pirogues ont promis de rentrer au bercail si l’État venait à arrêter les licences de pêche et permettre une régénération des ressources halieutiques. Parce qu’ils gagnaient plus ici qu’en Europe», a-t-il confié.
A l’en croire, pas moins d’une cinquantaine de bateaux ont profité d’autorisation de pêche. Dès lors il prend pour responsables tous ces pays ayant accepté ces accords de pêches.
«Tous les pays concernés ont une part de responsabilité sur ce qui se passe actuellement pour avoir vendu des licences de pêches à ces gros bateaux qui pompent nos ressources halieutiques. C’est pourquoi la pêche artisanale a des problèmes. Si l’État ne fait rien pour stopper cette saignée, la situation va empirer et nos ressources halieutiques vont disparaître.
Comment on peut concevoir qu’une caisse de Yaboye (sardinelles) coûte au Sénégal 100 000 FCFA. C’est une aberration, elle coûtait 3000 FCFA maximum, en 2012. Je me rappelle qu’on pouvait acheter un seau plein de poissons à 1500 FCFA. Mais en 2018, la situation a drastiquement changé. Ces cinq dernières années, les prix ont augmenté vertigineusement. Le panier pouvait coûter 20 000 ou 30 000 FCFA. Mais, cette année, c’est 100 000 FCFA le panier, à prendre ou à laisser. Il faut le dire : les pêcheurs artisanaux souffrent. On peut passer des jours en mer, à pêcher sans rien attraper», déplore-t-il.
«Pourtant lors de notre rencontre avec le chef de l’État au palais de la République, on avait évoqué nos difficultés devant lui. C’était en 2019. Il nous a dit qu’il n’était pas au courant. Et si les acteurs prennent la peine de vous expliquer, il faut prendre les mesures idoines. Mais au Sénégal, on a cette manie de la politique de l’autruche. On doit surveiller les bateaux qui entrent au port de Dakar. Il y a des non-dits.
Il y a une organisation qui supervise de près la transparence dans la gestion des ressources halieutiques. L’État du Sénégal avait annoncé qu’il allait y adhérer. La Mauritanie y a déjà adhéré. Mais notre pays traîne toujours les pieds. Ils disent publier la liste des bateaux qui ont des licences de pêche au Sénégal, mais nous n’avons toujours pas accès à cette liste et cela dure depuis des années», s’énerve-t-il.
Alors, s’inquiète M.Dièye : «si rien n’est fait, on risque de ne plus avoir du poisson dans nos plats. Le poisson risque d’être un produit de luxe pour certains Sénégalais dans les années à venir».
«Si l’État ne fait rien pour stopper cette saignée, la situation va empirer et nos ressources halieutiques vont disparaître»
C’est pourquoi il pense que «l’Etat du Sénégal a l’obligation d’effectuer des audits sur ce qui se passe dans nos eaux pour sauvegarder nos ressources halieutiques et préserver l’intérêt de la pêche artisanale». Mieux, ajoute le président de l’UNAPARS «pourtant, en préservant l’intérêt de la pêche artisanal, l’Etat va gagner plus. C’est ce qui se passe actuellement en Mauritanie. Il faut payer pour pouvoir entrer dans leur zone. La licence ne dure que 6 mois. Chaque six mois, on a l’obligation d’en acheter une autre.
Alors que le Sénégal depuis 2005, il vend des permis de pêche. C’était 22 000 pirogues. Depuis lors les chiffres ont doublé. Si l’Etat avait pris l’initiative de moderniser la pêche artisanale, il pourrait vendre les permis à 200 000 FCFA au lieu de 25 000 FCFA. Et la mer serai protégée et rentable pour nous. Les produits halieutiques sont très précieux, mais l’Etat n’a pas pris les mesures idoines pour les protéger».
Vox populi