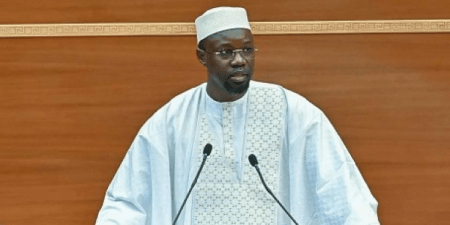Vers le 26 mai 2020, la police de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé que Raphaël Yanyi, un juge de haut rang, « avait subi une crise cardiaque présumée » ayant conduit à son décès.
Le ministère de la Justice a toutefois rapidement précisé que la dépouille du juge « ne présentait aucune substance toxique ».
Après une autopsie, le ministre de la Justice, Célestin Tunda Ya Kasende, a révélé que le juge Yanyi était mort « à coups de pointes acérées ou d’objets ressemblant à des couteaux, qui lui ont été enfoncés dans la tête ».
Contrairement à ce qu’affirme la police, le juge n’est pas mort d’une crise cardiaque. Il a plutôt été assassiné.
Au moment de son assassinat, Raphaël Yanyi présidait le procès pour corruption très médiatisé de Vital Kamerhe, chef de cabinet du président Félix Tshisekedi.
Les assassins de Raphael Yanyi n’ont pas encore été démasqués et il est impossible à l’heure actuelle de dire s’il s’agissait d’acteurs étatiques ou non étatiques.
Le juge Mavedzenge, avocat zimbabwéen, fait la distinction entre les attaques contre l’indépendance des juges d’une part et la persécution des juges d’autre part. Alors que les premières sont généralement institutionnelles, les secondes visent à nuire à la vie, à la personne ou au bien-être des juges et de leurs familles.
Cela va au-delà de l’instrumentalisation de l’éthique judiciaire ou du ciblage des juges pour des raisons politiques. Ce n’est pas vraiment une nouveauté en Afrique.
Le 21 septembre 1972, par exemple, des éléments de l’armée du maréchal ougandais Idi Amin Dada ont enlevé le juge en chef Benedicto Kiwanuka, dans son cabinet à la Cour suprême de l’Ouganda. Quatre jours plus tard, le maréchal Amin a abattu son captif, le juge en chef Kiwanuka, au State Lodge de Nakasero, à Kampala, la capitale de l’Ouganda.
Près de 10 ans plus tard, le 30 juin 1982, des inconnus ont enlevé trois juges en exercice de la Haute Cour du Ghana : Cecilia Koranteng-Addow, Frederick Poku Sarkodee et Kwadwo Agyei Agyepong. Ils ont transporté les juges au champ de tir militaire de Bundase, près d’Accra, où ils ont été abattus.
Pour dissimuler l’acte, les auteurs ont mis le feu à leurs corps. Leurs restes calcinés ont été retrouvés le lendemain matin.
Joachim Amartey Quaye, un membre éminent du Conseil provisoire de défense nationale (PNDC), au pouvoir, était l’une des personnes reconnues coupables du meurtre des juges. Il a ensuite été exécuté par un peloton d’exécution le 18 août 1983.
Les gouvernements élus que l’on trouve aujourd’hui dans la plupart des pays d’Afrique sont censés être plus subtils. L’arc contemporain prédominant de la trajectoire judiciaire sur le continent reflète des tendances croisées à la fois de « capture des tribunaux par le régime » et d’abdication volontaire de l’indépendance par les plus hauts niveaux de direction judiciaire.
Il existe cependant de nombreux exemples de juges intègres et courageux. Pour les faire rentrer dans le rang, ils sont de plus en plus la cible de persécutions et de violences.
L’hypothèse selon laquelle l’État, le gouvernement ou les partis politiques au pouvoir ont le monopole de ce type de malfaisance semble être confirmée à la fois par l’expérience et par les faits.
C’est également l’État ou les partis au pouvoir qui sont les mieux placés pour utiliser les mécanismes de l’éthique judiciaire comme une arme afin de terroriser les juges intègres et de les soumettre.
Cependant, dans de nombreux pays africains, les monopoles présumés de l’État sont aujourd’hui contestés par diverses entités.
Au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique, au Niger, au Nigéria, en Somalie et au Soudan – pour ne citer que quelques exemples – il existe des belligérants, des insurgés ou des mouvements armés qui exercent des pouvoirs quasi étatiques, leur permettant de cibler à volonté les magistrats ou d’autres agents publics ou de leur nuire.
Face à la lente montée en puissance de cette réalité au Nigéria, par exemple, des efforts concertés ont été déployés pour la nier ou éviter de lui conférer le sceau d’une reconnaissance officielle.
Au début de janvier 2012, par exemple, un inconnu armé est entré dans la maison de Baba Loskurima, greffier de la Haute Cour de l’État de Borno, dans le nord-est du Nigéria, et « a tiré plusieurs coups de feu dans la tête et la poitrine de Baba avec un fusil Kalachnikov devant sa femme et ses enfants ». Il n’avait aucune chance de survivre.
Neuf mois plus tard, en septembre de la même année, Zanna Mallam Gana, le procureur général de l’État de Borno, a également été assassiné.
Les meurtres de Baba Loskurima et de Zana Mallam Gana ont été soupçonnés d’avoir été commis par des assassins du groupe insurgé islamiste Boko Haram.
Ce n’étaient pas les premières attaques perpétrées par des acteurs présumés non étatiques au Nigéria, visant à nuire aux juges. En 2009, Florence Duroha-Igwe, juge à la Haute Cour de l’État d’Imo, dans le sud-est du Nigéria, a été victime d’une agression au cours de laquelle son chauffeur et un policier ont été grièvement blessés par balle.
L’année suivante, le juge-président de la Cour d’appel coutumière de l’État, Ambrose Egu, et la magistrate principale, Pauline Njemanze, ont été enlevés près de l’aéroport international de fret Sam Mbakwe, à Owerri, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
En mars 2011, les juges de la Haute Cour de l’État se sont lancés dans une grève pour protester contre l’enlèvement de l’un de leurs collègues, Theophilus Nzekwe.
Enhardis par l’incapacité de l’État nigérian à exiger des comptes, les auteurs de ces attaques ont gagné en audace et en intensité et ont commencé à échanger des juges contre des rançons.
En octobre 2019, une juge d’appel principale de l’État d’Imo, Chioma Nwosu-Iheme, a été enlevée à Benin City alors qu’elle était en service pour présider des litiges électoraux. Elle a passé quinze jours en captivité.
En septembre 2021, l’ancienne juge en chef de l’État d’Abia, Nnenna Oti, a été enlevée à Orlu, dans l’État d’Imo. Sept mois plus tôt, la juge d’appel d’Owerri, Rita Pemu, avait besoin d’un supplément de ruses indigènes pour survivre aux périls d’un enlèvement.
Les auteurs non étatiques des dernières attaques contre la sécurité des juges nigérians ne sont plus désireux de cacher leur origine. Janet Gimba, juge de la Haute Cour coutumière de l’État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigéria, a été enlevée avec quatre de ses enfants le 24 juin 2024 par des bandits réputés qui ont brutalement tué l’un des enfants afin de faire valoir leur marché à la fois contre de l’argent et des prisonniers. Les enfants ont été libérés après 15 jours de captivité.
En juin, le jour où la juge Janet Gimba et ses enfants ont été enlevés, dans les régions frontalières de Borno-Yobe, dans le nord-est du Nigéria, des éléments soupçonnés d’appartenir à l’État islamique, province d’Afrique de l’Ouest (ISWAP), ont enlevé Haruna Mshelia, juge principal de la Haute Cour de l’État de Borno, ainsi que sa femme Binta (qui soignait une fracture), leur chauffeur et un aide-soignant.
Pendant deux ans jusqu’en 2010, avant sa nomination comme juge, Haruna Mshelia était président de l’Association du barreau nigérian (NBA), à Maiduguri.
Bien que le sort du juge, de son épouse et de leur personnel reste incertain, il est prudent de donner la priorité à leur retour en toute sécurité. Il est donc peut-être prématuré de s’attarder de trop près sur leur cas. Il n’est cependant pas difficile de spéculer sur les raisons pour lesquelles un juge principal, profondément respecté pour son intégrité, pourrait être la cible d’un enlèvement par un acteur quasi étatique armé comme l’ISWAP.
La véritable question qui doit être posée est de savoir comment les institutions légitimes de l’État et de la société civile organisée devraient réagir à ce genre de situation.
77 jours après l’enlèvement de ce juge de haut rang et de sa femme, il existe très peu d’informations officielles ou publiques sur leur sort ou sur les efforts déployés pour les libérer. Cela pourrait bien sûr être dû au fait que les autorités publiques ont décidé que c’était la meilleure garantie pour leur retour en toute sécurité.
La bonne nouvelle est que cela suggère que le gouvernement est convaincu que le juge, sa femme et les autres personnes enlevées avec lui sont en vie.
Le risque, cependant, est que cela pourrait également permettre au gouvernement de démobiliser la pression pour leur retour en toute sécurité. Cela pourrait garantir leur effacement de la conscience publique et, pire encore, rapprocher le jour où l’enlèvement par des acteurs non étatiques de juges consciencieux deviendra la norme dans le pays le plus peuplé d’Afrique.
Avocat et enseignant, Odinkalu peut être contacté à l’adresse chidi.odinkalu@tufts.edu