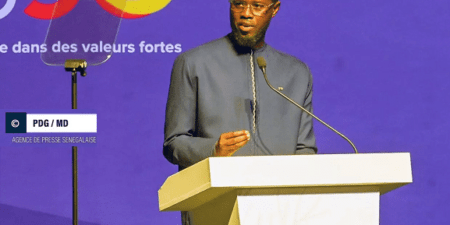Au cœur des collines vallonnées de la province de Gitega, au Burundi, Jacqueline Hakizimana, 42 ans, observe ce champ qui lui a donné tant de fil à retordre.
Ce terrain ingrat où rien ne poussait, où les semences se transformaient en poussière, est devenu aujourd’hui un îlot de verdure, où maïs et haricots s’épanouissent en rangs réguliers. Depuis plus de 30 ans, Jacqueline pratique l’agriculture; elle a hérité ce mode de vie de sa famille, qui vivait non loin de là, sur la colline Kiremera.
Pourtant, malgré son expérience, elle n’obtenait que de piètres résultats.
Elle n’avait que des semences de mauvaise qualité et ne savait pas comment s’y prendre pour fertiliser le sol de manière efficace.
«Je me souviens avoir semé 100 kilogrammes de haricots sur une surface de deux hectares, et n’en avoir récolté que 90», déplore-t-elle, en indiquant que sa récolte était inférieure à ce qu’elle avait planté.
Ses techniques agricoles rudimentaires lui ont été transmises par ses parents ou ses voisins et, tous les ans, les récoltes s’avéraient décevantes. Elle cultivait des haricots, du maïs, du manioc, des patates douces et des pois cajans, mais la production suffisait à peine à nourrir la famille – elle, son mari et leurs quatre enfants.
«Nous mangions le peu que nous récoltions, et je devais acheter le reste au marché», se souvient-elle.
«Je me disais que mes enfants devraient se débrouiller seuls pour survivre», ajoute-t-elle, en se rappelant les perspectives qui se dessinaient alors.
C’est à cette période que Jacqueline a entendu parler des écoles pratiques d’agriculture mises en place par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les écoles pratiques d’agriculture sont un programme pratique et concret permettant aux agriculteurs d’apprendre de meilleures techniques lors de démonstrations sur le terrain.
«J’ai entendu parler de ces écoles lors d’une séance de formation menée par un agronome dans notre région», explique-t-elle. L’idée de créer une nouvelle entreprise peut sembler risquée, mais Jacqueline n’était pas inquiète. «Je me sentais sûre de moi, car j’étais avec d’autres femmes de ma communauté», dit-elle.
Les écoles pratiques d’agriculture ont permis à Jacqueline de découvrir plusieurs innovations qui ont contribué à révolutionner ses activités agricoles. Le changement le plus important a été la transformation des groupes issus de ces écoles en coopératives, l’objectif étant d’améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés. Elle fait aujourd’hui partie d’une coopérative, qui lui permet non seulement d’apprendre de meilleures techniques, mais aussi de prendre part à un réseau plus vaste qui l’aide à accéder aux marchés, à vendre ses produits et à augmenter ses revenus.
Durant les premiers jours qu’elle a passés dans cette école, Jacqueline a reçu une formation pratique à la gestion des cultures et à la conservation des sols. Elle a appris à semer en rangs, à utiliser des semences de meilleure qualité et à gérer ses sols avec des courbes de niveau et des pratiques agroforestières permettant de limiter l’érosion.
«J’utilisais auparavant de grandes quantités de semences et récoltais très peu de produits», se souvient-elle. «Aujourd’hui, je sème de petites quantités, et les récoltes sont plus abondantes, alors que je cultive le même champ.»
Le tournant décisif a eu lieu lorsque Jacqueline a appliqué ses nouvelles connaissances. «J’ai planté 70 kilogrammes de maïs sur deux hectares et récolté 1 600 kilogrammes de grains», raconte-t-elle. Ces bons résultats lui ont permis d’acheter un terrain de 0,5 hectare.
Grâce à l’argent issu de la vente des végétaux produits par la coopérative, Jacqueline a pu acheter avec sa famille deux vaches d’une meilleure variété, cinq chèvres et six lapins, ce qui lui a permis de contribuer encore davantage à la durabilité de sa ferme grâce au fumier produit, qui est un engrais organique. «J’ai aujourd’hui les moyens d’acheter des choses que je n’aurais jamais imaginé pouvoir m’offrir, comme mon propre terrain», se réjouit-elle.
Son esprit d’initiative s’est également développé, et Jacqueline est maintenant présidente de la coopérative Turwanyubukene, qui signifie «Ensemble pour vaincre la pauvreté». Aujourd’hui, elle forme d’autres membres de la coopérative aux techniques agricoles qu’elle a appris à maîtriser, et son influence rayonne dans toute la communauté. Sa coopérative cultive 12 hectares de différentes cultures et dispose de 400 kilogrammes de maïs en stock, ainsi que d’une épargne à la banque.
Leur prochain projet est de construire un entrepôt pour y stocker les récoltes et d’installer un moulin pour valoriser leur production de maïs. «Notre objectif actuel est de réunir les récoltes des ménages alentour, de les stocker et de les transformer pour les vendre au marché», précise Jacqueline.
Ce passage de l’agriculture de subsistance à une agriculture commerciale a été rendu possible par la stratégie globale de la FAO consistant à faciliter l’accès des petits agriculteurs aux marchés locaux et nationaux. Selon Jacqueline, le projet a pour vocation d’offrir davantage de perspectives grâce à l’action collective. «En travaillant avec d’autres agriculteurs, nous avons pu mettre en commun nos acquis, tirer les leçons des parcelles témoins et vendre ensemble nos produits au marché», explique-t-elle.
Au Burundi, les femmes jouent un rôle déterminant pour le succès du modèle coopératif. Les femmes représentent 78,3 pour cent des membres des écoles pratiques d’agriculture et des coopératives du pays, et occupent 73 pour cent des fonctions de prise de décisions au sein des comités consacrés aux chaînes de valeur durables.
Leur esprit d’initiative a permis de restaurer des terres dégradées, de mettre en place la rotation de cultures et l’agriculture biologique et d’améliorer la nutrition des ménages. Par ailleurs, les recettes générées par les femmes ont permis d’augmenter les revenus des ménages de 20 pour cent en moyenne.
«Les femmes ont joué un rôle moteur pour la majorité de ces changements», déclare Dieudonné Kameca, spécialiste des chaînes de valeurs de la FAO au Burundi.
Malgré ces résultats impressionnants, il reste des défis à relever. L’accès au crédit, les retards dans l’obtention du matériel et la volatilité des marchés agricoles continuent de freiner les progrès. La FAO mène des études de marché, améliore la mise en commun des informations sur les prix et favorise l’esprit d’entreprise des agriculteurs pour remédier à ces problèmes.
«Avec l’aide et les ressources appropriées, la transformation n’est pas seulement possible, elle est inévitable», dit Vincent Martin, Directeur du Bureau de l’innovation de la FAO. «Même dans les environnements les plus difficiles, les agriculteurs peuvent surmonter les épreuves et travailler dur pour s’en sortir, et ouvrir ainsi la voie vers un avenir plus radieux pour leurs familles et leurs communautés.»
Ainsi, Jacqueline a transformé son exploitation en entreprise prospère. «Je pensais que mes enfants devraient batailler comme j’ai dû le faire», raconte-t-elle. «Aujourd’hui, je sais qu’un avenir meilleur les attend.»
Les activités menées par la FAO au Burundi ne concernent pas seulement la production agricole, elles ont aussi pour objectif de bâtir des communautés résilientes capables de relever les défis économiques et environnementaux. Les agriculteurs de la province de Gitega sont aujourd’hui à la tête d’un mouvement de redynamisation de l’agriculture au Burundi. Avec l’aide appropriée, la transformation est toujours possible.
L’histoire originale et les photos associées sont disponibles sur:
Source www.fao.org/newsroom/story/innovation-lays-the-path-to-prosperity/fr