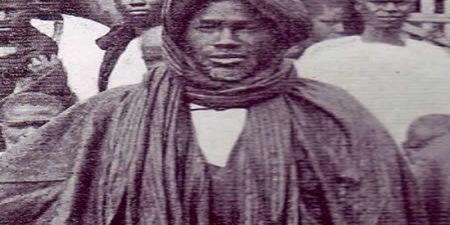Lors de sa mort à 80 ans en juin 2008, Lamidi Aribiyi Adedibu était l’un des parrains politiques les plus connus de sa génération et certainement l’un des plus perturbateurs du Nigeria. À Ibadan, dans l’État d’Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, où il régnait, Adedibu était réputé pour avoir « fait d’un simple aspirant à la présidence un gouverneur ; d’un vice-gouverneur un prétendu vulcanisateur ; d’un sénateur un charpentier ; d’un député républicain un garçon de voiture – tout cela par l’instrument de la force et du subterfuge. »
À propos de sa politique, décrite comme « violemment démocratique », Adedibu a fait valoir que tout cela était conçu pour rendre la ligne de succession aux hautes fonctions exécutives à la fois prévisible et dépourvue de drame inutile, tout comme c’est le cas pour la succession à la monarchie en Angleterre.
La succession dans un système électif n’est bien sûr pas censée reproduire la prévisibilité du droit monarchique. Au Nigéria, la seule exception à cette règle est la succession au poste de juge en chef. Au cours de la semaine où le Sénat a confirmé de manière supersonique le nouveau juge en chef du Nigéria (CJN), il peut être utile de rappeler que la succession à ce poste n’a pas toujours été dénuée de drame.
Jusqu’à cette semaine, 22 personnes avaient occupé le poste de juge en chef depuis la fusion de 1914. Edwin Speed a occupé ce poste pendant quatre ans, de 1914 à 1918. Ralph Combe lui a succédé jusqu’en 1929. Donald Kingdon, qui a exercé les fonctions de juge en chef du Nigéria colonial jusqu’en 1946, reste le plus ancien titulaire de ce poste, l’ayant occupé pendant près de dix-sept ans à partir de 1929. John Verity lui a succédé pendant huit ans jusqu’en 1954, suivi de Stafford Foster-Sutton, le dernier des juges en chef coloniaux, qui a exercé ses fonctions jusqu’en 1958.
En 1957, il était clair que Sir Stafford quitterait son poste l’année suivante. Les manœuvres pour lui succéder ont commencé sérieusement pour le rôle historique de premier juge en chef autochtone du Nigéria. À l’époque, Olumuyiwa Jibowu, avocat depuis 1923 et juge à la Haute Cour depuis 1942, était considéré comme le mieux placé pour ce poste. Il fut également le premier juge nigérian de la Cour suprême fédérale. Sir Olumuyiwa précéda son plus proche concurrent, Adetokunbo Ademola, au barreau de 11 ans et à la magistrature de sept ans. Ses références semblaient irréprochables. À l’époque, Sir Adetokunbo était juge en chef de la région occidentale.
Lors de la session parlementaire de 1957, le membre de la Chambre des représentants représentant Owerri, Dennis Abii du Conseil national du Nigéria et du Cameroun (NCNC), a déposé une motion demandant au gouverneur général de « prier Sa Majesté la Reine de démettre M. le juge Jibowu de ses fonctions de juge, au motif qu’il a pris parti dans la politique partisane, comme le révèle la lettre qu’il a écrite à un certain M. Savage ». Écrite trois ans plus tôt, en 1954, la lettre de Sir Olumuyiwa contenait des propos peu élogieux à l’égard du Dr Azikiwe et de son NCNC.
Le Dr Nnamdi Azikiwe était une figure de proue de la politique anticoloniale du Nigeria, qui allait plus tard devenir le premier dirigeant postcolonial du Nigeria. Suite à la motion de Dennis Abii, le NCNC a imprimé et diffusé la lettre présumée de Sir Olumuyiwa pour faire valoir son point de vue selon lequel il était trop partisan pour être juge en chef. Cette controverse a donné du poids aux ambitions alors lointaines de Sir Adetokunbo, qui a finalement émergé le 1er avril 1958 pour devenir le premier juge en chef autochtone du Nigeria.
Au cours des deux décennies suivantes, le bureau du CJN n’a évolué que progressivement, sans jamais perdre son caractère essentiel de premier parmi ses pairs. À cette époque également, la nomination à ce poste a toujours été une source de drame et d’imprévisibilité. Lorsque Sir Adetokunbo a pris sa retraite en 1972, le gouvernement militaire fédéral a nommé comme successeur Taslim Elias, un universitaire dont le mandat de procureur général de la Fédération a été parallèle à celui de Sir Adetokunbo en tant que juge en chef pendant presque sept mois depuis l’indépendance en octobre 1960.
Lorsque le professeur Elias a abdiqué son poste de juge en chef de la Cour suprême en 1975, l’armée a nommé Sir Darnley Alexander, un rédacteur juridique d’origine caribéenne et, à l’époque, juge en chef de l’État du Sud-Est. Sir Darnley s’est naturalisé nigérian tout en occupant le poste de juge en chef de la Cour suprême.
Dans des circonstances quelque peu controversées, en août 1979, le gouvernement militaire sortant a nommé Atanda Fatayi Williams au poste de juge en chef de la Cour suprême
en remplacement de Sir Darnley qui partait à la retraite. Ainsi a commencé une convention, qui subsiste encore aujourd’hui, de désignation pour ce poste du juge le plus ancien de la Cour suprême.
Compte tenu de cette convention, il était tout à fait prévisible que Kudirat Kekere-Ekun succède à Olukayode Ariwoola pour devenir le 18e juge en chef de la Cour suprême autochtone. En tant que juge le plus ancien de la Cour suprême, son accession au poste semblait inexorable. En vertu de la constitution, le président procède à la nomination après confirmation du candidat par le Sénat.
Dans ce cas, le Sénat a conclu l’audience de confirmation dans le cadre d’un processus de pure forme, programmé sans avis public ni participation. En plus de confirmer la nomination du candidat au poste prestigieux de CJN, ce processus a aussi malheureusement confirmé la prise de contrôle de ce poste par une petite tribu de politiciens égoïstes.
Dans cette confirmation la plus récente, les politiciens semblaient seulement vouloir obtenir du candidat des garanties pour assurer l’appropriation politique du poste de CJN et l’exclusion de la responsabilité publique du pouvoir judiciaire. Le président du Sénat, Godswill Akpabio, lui a posé une question très douce sur la façon de mettre fin au débat public sur des décisions judiciaires incroyables comme celle qui a fait d’Akpabio et de son prédécesseur, Ahmad Lawan, des candidats au Sénat lors de primaires auxquelles ils n’ont pas participé.
La réponse a été élogieuse : « Je tiens à vous assurer qu’en tant que président de la Commission des privilèges des praticiens du droit, nous veillerons à ce que ceux qui devraient être sanctionnés, ceux qui ont l’habitude de parler sur les réseaux sociaux, de condamner le pouvoir judiciaire, de commenter des affaires en instance, n’aient nulle part où se cacher. Ils seront traités avec fermeté. »
Le président du Sénat rayonnait d’une corpulence méprisante caractéristique.
Le résultat n’a jamais fait de doute. Les politiciens ont obtenu l’assurance qu’ils continueraient à contrôler le pouvoir judiciaire. En retour, le candidat a été confirmé sans incident.
L’accès au poste pourrait désormais suivre un modèle que Lamidi Adedibu aurait prescrit avec enthousiasme, mais le sort de ses trois prédécesseurs immédiats doit être riche d’immenses leçons pour le nouveau CJN.
Premièrement, le juge en chef est peut-être devenu un potentat constitutionnel, mais la leçon à tirer du sort de Walter Onnoghen au poste de juge en chef est que ce potentat a les pieds d’argile. Les mêmes politiciens qui ont réussi à placer le juge en chef au-dessus de la constitution peuvent décapiter l’occupant quand cela leur convient.
Deuxièmement, le juge en chef est peut-être bien plus qu’un simple premier parmi ses pairs de nos jours, mais une leçon évidente du sort de Tanko Muhammad au poste de juge en chef est qu’un juge qui néglige le bien-être de ses pairs peut ne pas durer dans ce rôle.
Troisièmement, un juge en chef doit penser à son héritage et, celui qui se comporte avec l’abandon d’un marin politique ivre, comme Olukayode Ariwoola – l’ancien occupant immédiat de la fonction – peut hériter du monde matériel mais perdre l’âme de la magistrature.
Pour le moment, nous devons accueillir à cette haute fonction seulement la deuxième femme à occuper la fonction de juge en chef. Elle aura le temps de décider si (comme la première femme à occuper ce poste) elle choisit de considérer cela comme une grande responsabilité ou, comme son prédécesseur immédiat, si elle préfère le considérer comme une fonction.
Avocate et enseignante, Odinkalu peut être contactée à l’adresse chidi.odinkalu@tufts.edu