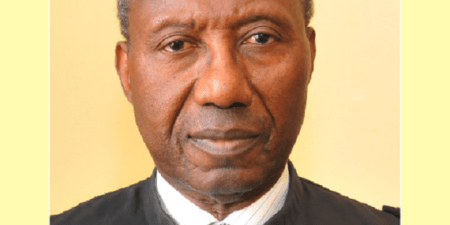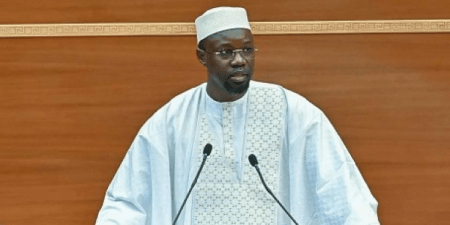Un papier est partagé sur les réseaux sociaux sur la situation financière délicate de Dangote, milliardaire nigérian ayant massivement investi dans une raffinerie moderne, il illustre les défis structurels et politiques auxquels sont confrontées les industries en Afrique. Cette note explore les externalités économiques, les chaînes de valeur et les choix délibérés de corruption active entre corrupteurs et corrompus, tout en mettant en lumière les implications pour le développement industriel du continent.
La corruption active, où les deux parties tirent un bénéfice personnel au détriment de l’intérêt général, engendre des externalités négatives substantielles. Ces pratiques faussent les mécanismes du marché, détournent les ressources publiques et réduisent l’efficacité des investissements. Selon Transparency International, la corruption coûte à l’Afrique plus de 50 milliards de dollars chaque année, représentant une fuite de capitaux qui pourrait autrement être investie dans des infrastructures et des services publics essentiels.
Dans l’industrie pétrolière, les chaînes de valeur incluent l’exploration, la production, le transport, le raffinage et la distribution des produits pétroliers. Le Nigeria, qui a commencé à exploiter commercialement son pétrole en 1958, produit environ 2 millions de barils de pétrole brut par jour, soit environ 730 millions de barils par an. Cependant, malgré cette production massive, le pays importe environ 90 % de ses produits pétroliers raffinés. En 2020, le Nigeria a importé environ 20,89 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés.
En termes de valeur, les exportations de pétrole brut du Nigeria se sont élevées à environ 27,3 milliards de dollars en 2021, tandis que les importations de produits pétroliers raffinés ont coûté au pays environ 20,3 milliards de dollars la même année. Cette situation met en évidence un paradoxe où un pays riche en ressources naturelles est contraint de dépenser une part significative de ses revenus d’exportation pour importer des produits qu’il pourrait théoriquement raffiner localement.
L’affaire Diezani Alison-Madueke, ancienne ministre du Pétrole du Nigeria, illustre bien ce problème. Accusée de corruption massive, elle aurait détourné environ 2,5 milliards de dollars pendant son mandat. Ces fonds auraient pu financer plusieurs raffineries, améliorant ainsi l’autosuffisance énergétique du Nigeria. Des rapports indiquent que ses biens, évalués à des centaines de millions de dollars, incluent un manoir à Banana Island, Lagos, acheté pour 37,5 millions de dollars, et divers actifs saisis aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Au Sénégal, plusieurs filières sont confrontées à des défis similaire, filières pêche, tomates, etc. Concernant la filière coton, le pays produit des milliers de tonnes de coton chaque année, mais la transformation locale est limitée.
La SODEFITEX, avec cinq égreneuses capables de produire 65 000 tonnes de fibres, est une entreprise clé dans la production de coton au Sénégal. Cependant, une grande partie du coton produit est exportée au lieu d’être transformée localement. ICOTAF, spécialisée dans la transformation du coton, avait une capacité de production importante mais a souffert de sous-utilisassions en raison de la priorité donnée à l’exportation du coton brut. Icotaf, la Sotiba la SCT, les TMS (Tricoteries mécaniques du Sénégal), la SIV (Société industrielle du vêtement) ont également connu des difficultés similaires liées à la sous-utilisation des capacités de production, même si elles ont eu des problèmes de gouvernance.
En 2021, le Sénégal a exporté du coton pour une valeur d’environ 9 millions de dollars, tandis que les importations de tissus et de vêtements en coton ont coûté au pays près de 100 millions de dollars.
Cela illustre le manque à gagner en termes de valeur ajoutée et d’emplois locaux. Les capacités de production des usines de filatures et de tissage ne correspondent pas toujours au tonnage de coton produit.
En 2020, par exemple, le Sénégal a produit environ 32 000 tonnes de coton, mais la transformation locale est restée faible en raison des priorités d’exportation. Les exportations de coton brut restent élevées, car elles sont souvent plus lucratives pour les entreprises et les décideurs qui perçoivent des commissions sur ces transactions.
Les choix délibérés de corruption active ont des implications profondes pour le développement économique de l’Afrique. Ils entravent la croissance industrielle, exacerbent les inégalités et perpétuent la dépendance aux importations. Pour inverser cette tendance, il est essentiel d’adopter des politiques transparentes et de renforcer la gouvernance. Des initiatives telles que celles de DOMITEXKA, qui exporte 80 % de ses produits finis vers les pays voisins, montrent le potentiel de la transformation locale.
Investir dans des infrastructures locales, réduire la corruption et promouvoir une gouvernance transparente sont des étapes cruciales pour revitaliser les chaînes de valeur en Afrique. En mettant en place des mécanismes pour assurer la traçabilité et la transparence des transactions, les pays africains peuvent maximiser les bénéfices de leurs ressources naturelles et promouvoir un développement économique durable et inclusif.
Il est souvent avancé que les populations africaines ne sont pas suffisamment entreprenantes ou industrielles. Toutefois, cela est en grande partie dû à un contexte mondial qui ne permet pas une industrialisation effective.
Les obstacles structurels, les barrières commerciales et la domination des multinationales étrangères empêchent souvent le développement d’industries locales. Par ailleurs, la corruption locale exacerbe ces défis en décourageant les investissements et en détournant les ressources nécessaires au développement.
La situation de Dangote et des autres industries locales en Afrique révèle un schéma où la corruption et les commissions excessives freinent le développement des capacités de transformation locale. Pour renverser cette tendance, des politiques transparentes et favorables à l’investissement local sont essentielles. De plus, renforcer la gouvernance et promouvoir l’autosuffisance en transformant localement les ressources peut contribuer à une croissance économique durable et inclusive pour les pays africains.
Par
Ramona Yade