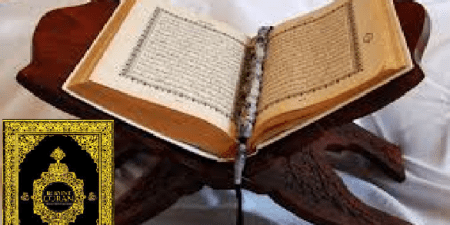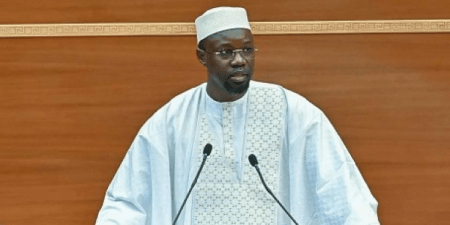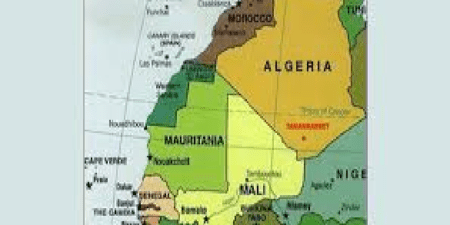Entre autres choses, des urnes illégales sont installées en Californie et d’anciennes tactiques de suppression des électeurs sont à nouveau utilisées, d’après Transparency International.
L’argent reste également problématique. Les dépenses pour le cycle électoral pourraient atteindre 11 milliards de dollars US incompréhensibles, estime le Center for Responsive Politics. Cela double presque le montant de 2016.
Sans surprise, mais toujours difficile à comprendre, quelques milliardaires donnent une part importante de cet argent. Ils peuvent faire un don illimité aux Super PAC (qui ont dépensé 1,1 milliard de dollars jusqu’en octobre), ou ils peuvent rester anonymes s’ils donnent leur argent à des organismes sans but lucratif de protection sociale.
Ces dons anonymes constituent ce qu’on appelle «l’argent noir». L’argent massif soulève la question de savoir à qui l’intérêt peut prévaloir s’il faut choisir entre des réductions d’impôts pour les généreux donateurs ou des dépenses sociales lors de l’équilibrage des feuilles budgétaires.
La part du lion des dépenses publicitaires, 7 milliards de dollars, va à la publicité numérique sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming vidéo où l’opacité est monnaie courante. La publicité numérique a masqué qui se cache derrière une annonce et combien d’argent y va.
Les échappatoires qui permettent des flux non contrôlés de monnaie noire ne sont pas exclusives aux États-Unis.
Lundi, le peuple néo-zélandais a réélu Jacinda Ardern dans une victoire écrasante – un exploit rare en Nouvelle-Zélande. Le cadre réglementaire ici manque également de protections solides contre l’utilisation de mauvaise foi des plates-formes numériques dans les campagnes électorales.
La faiblesse des lois sur la divulgation signifie que les acteurs de mauvaise foi n’ont pas à divulguer leurs dépenses ou leurs sources de financement. La Commission électorale étant incapable de surveiller le respect par les entreprises de technologie des lois existantes et des limites de seuil de publicité inadaptées à des campagnes en ligne à faible coût, «l’argent noir» est également possible en Nouvelle-Zélande.
Certes, la publicité politique en ligne a ouvert des opportunités de contact et de connexion avec les électeurs. Pourtant, des préoccupations légitimes subsistent quant à la manière dont les entreprises technologiques telles que Facebook et Google gèrent la transparence. Sans parler des plateformes de streaming vidéo considérées comme le «far west des publicités politiques». Lorsqu’il existe tant de preuves que les intérêts étrangers prospèrent dans l’opacité des plates-formes pour interférer avec les élections, il est temps d’agir.
Nous n’avons plus besoin de preuve de l’efficacité désastreuse de ces plateformes pour influencer et contrarier les électeurs.