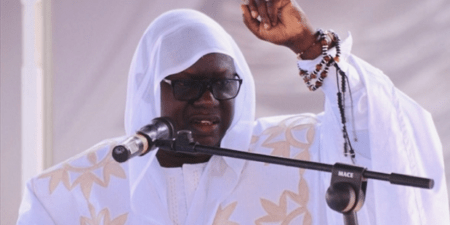Dans un contexte de pandémie qui met en lumière les besoins de connaître et de comprendre les dimensions sociales des épidémies, un atelier de formation international se tient à Dakar pour accroître les capacités d’analyse en socio-anthropologie dans la région Afrique de l’Ouest. C’est 27 participants qui sont des chercheurs, enseignants chercheurs et jeunes chercheurs venant de sept pays (Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Bénin, France) et des universités de Dakar, du Sine Saloum, de Bambey et de Ziguinchor.
Durant les deux dernières décennies, le monde en particulier l’Afrique est submergée par des épidémies comme Ebola, Vih, choléra et Covid-19. Pour remédier à cela, tout en faisant connaître et comprendre les dimensions sociales des épidémies, un atelier de formation international se tient à Dakar pour accroitre les capacités d’analyse en socio-anthropologie dans la région Afrique de l’Ouest. Cet atelier de 05 jours destiné à des socio-anthropologues travaillant au Sénégal ou en Afrique francophone a pour objectif de former des formateurs qui pourront développer la recherche, l’enseignement et la contribution des sciences sociales aux réponses sanitaires.
Selon Dr Khoudia Sow, médecin et anthropologue chercheure au niveau du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge de Fann (Crcf), le cadre de cette formation c’est un travail scientifique qui a été fait par le Réseau des anthropologues d’épidémies émergentes (Raee) créé́ en 2014 par des anthropologues travaillant sur l’épidémie d’Ebola.
« Ce Réseau regroupe un ensemble de chercheurs, d’anthropologues des pays du nord et du sud qui se sont mis ensemble pour réfléchir et apporter certain nombre d’outils pour la compréhension des épidémies », a-t-elle expliqué.
« L’idée c’est de partir à capitaliser nos expériences du Vih. Et pendant l’épidémie de la Covid-19, nous avons commencé à travailler, à réfléchir sur des éléments de compréhension de la réponse aux épidémies », ajoute Dr Khoudia Sow. Pour cette dernière, des outils de réflexion ont été élaborés avec des partenaires et mis dans un ouvrage, qui est un manuel qui capitule les principales questions qui peuvent se poser sur les épidémies émergentes à savoir : quel est le cadre général de la réponse aux épidémies, qu’est-ce que c’est une épidémie, quels sont les risques infectieux, quels sont les rapports des gens de la société et comment vont-ils interpréter ce risque, comment vont-elles se comporter. Cette formation qui est une première du genre, regroupe 27 participants (22 sur site, 5 à distance) qui sont des chercheurs, enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs venant de sept pays d’Afrique francophone (Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Bénin, France) et des Universités de Dakar, du Sine Saloum, de Bambey et de Ziguinchor.
« Ces chercheurs vont tous ensemble s’approprier ces outils-là, rentrer chez eux et offrir un cadre commun de réflexion et d’outils pour que ces principes d’épidémie émergente soient enseignés mais aussi pour leur permettre d’être des acteurs de la réponse », a-t-elle dit. D’après la chercheure au niveau du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge de Fann, des acteurs communautaires seront formés à leur tour pour voir comment ils vont pouvoir transmettre ces expériences aux populations, pour quand il y aura une nouvelle épidémie de savoir s’y prendre. Parce que, préconise-t-elle, «il est sûr nous faisons face à des risques des épidémies et nous faisons face à une augmentation du risque de la perception, du risque épidémique par les populations ».
Alice Desclaux, médecin et professeure d’anthropologie à l’Institut de recherche pour le développement (Ird), prenant la parole a déclaré que « cette formation est un ensemble de réflexions et d’expériences qui ont été rassemblées pour améliorer les interventions en matière d’épidémie ». Pour elle, « une épidémie est un phénomène complexe ». Pour y répondre, «il faut des médecins, épidémiologistes, des professionnels de santé publique et des anthropologues dont on trouve notre place ». Le maître mot de tous, selon elle, c’est le mot co-construction, co-réflexion les uns avec les autres, co-construction des chercheurs avec des acteurs, des anthropologues avec des médicaux et des personnes de plusieurs pays.
Dr. Karim Diop, secrétaire général du Centre régional de recherches de formation (CRCF), avance : « Nous avons débuté une formation extrêmement importante pour les ressources humaines de notre sous-région africaine puisqu’en fait, ça consacre à la formation sur un domaine particulier. Nous sommes en train de faire la formation des formateurs. Aujourd’hui, vous avez 6 pays qui sont autour de la table et qui vont donc au cours de la semaine, être formés pour pouvoir à leur tour dissimuler leurs connaissances et leurs expertises dans leur pays respectif ».