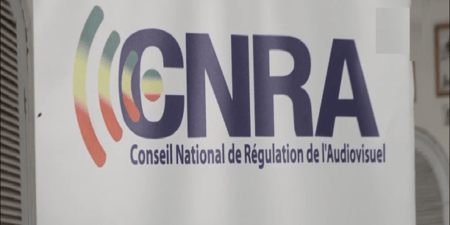Dans un monde aux prises avec des menaces environnementales, l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (GGWI) est apparue comme une solution africaine pour construire un avenir durable dans la vaste région du Sahel.
Lancée en 2007, l’initiative visait à fournir un bouclier vert contre l’avancée du désert, à préserver les terres fertiles pour l’agriculture et à renforcer la résilience climatique dans la zone située directement sous le Sahara – couvrant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Soudan. , Érythrée, Éthiopie et Djibouti.
En visant à trouver un équilibre délicat entre la restauration écologique et la protection des droits humains fondamentaux, les avantages tangibles pour des millions de personnes dans la région comprendraient une sécurité alimentaire accrue, un meilleur accès aux ressources naturelles vitales et des opportunités d’emploi grâce aux efforts de gestion des terres et de restauration.
Aujourd’hui, l’initiative traverse une immense étendue du continent africain avec plus de trente pays et de multiples organisations impliquées. Sa structure est conçue pour être globale et inclusive, mais présente des complexités inhérentes compte tenu de sa taille gigantesque.
Malgré son engagement en faveur de la bonne gouvernance, la GGWI a connu des défis critiques en matière de mise en œuvre et de coordination.
Pour que l’initiative soit menée à bien, sa mise en œuvre efficace nécessitera davantage de transparence, de responsabilité et une participation accrue des organisations de la société civile et de la communauté au sens large.
Quel est l’objectif et la structure de gouvernance de la Grande Muraille Verte ou GGWI ?
La GGWI a été conçue comme une réponse aux défis de la désertification, de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire dans la région africaine du Sahel.
À terme, le GGWI vise à restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées, à créer 10 millions d’emplois et à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone d’ici 2030 en utilisant une approche intégrée de gestion des terres.
L’ Union africaine (UA) a lancé l’initiative en 2007 et continue de superviser le projet, et a reçu le soutien de diverses organisations, dont les Nations Unies , la Banque mondiale et plusieurs pays donateurs.
L’initiative s’est étendue à toutes les régions géographiques du continent africain et plus de trente pays sont engagés dans différentes étapes de mise en œuvre. L’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (PAAGGW) a été créée en 2010 pour coordonner et surveiller la mise en œuvre de la GGWI et mobiliser les ressources nécessaires avec l’UA et les 11 pays situés directement sous le Sahara que le mur enjambera.
Ces 11 pays ont créé des agences nationales ou des points focaux pour superviser et coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires nationales de la GGWI. Ces agences travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales, les organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes.
Au niveau communautaire, des organisations et des groupes locaux sont impliqués, tels que les agriculteurs et les communautés autochtones. Leur implication est cruciale car ils possèdent des connaissances et une expérience précieuses dans l’environnement local.
En 2021, les dirigeants mondiaux présents au sommet One Planet ont lancé l’ Accélérateur de la Grande Muraille Verte (GGW) , hébergé par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui vise à soutenir le PAAGGW pour accélérer la vitesse à laquelle la GGWI peut produire des résultats. . Cela implique l’adoption d’une approche plus structurée de mise en œuvre, l’intensification des initiatives réussies, l’harmonisation de la mesure de l’impact et des rapports, et une meilleure intégration du secteur privé, de la société civile, de la recherche et de l’innovation dans les efforts de la GGWI.
Ce qui doit changer
Un rapport d’étape de 2020 a révélé que la GGWI avait collectivement restauré 4 millions d’hectares de terres dégradées à ce jour, soit seulement 4 % de l’objectif initial. Cependant, il est important de noter que 17,8 millions d’hectares de terres avaient été restaurés dans la région élargie de la GGWI en 2018. Une série d’activités auraient également eu des avantages environnementaux et socio-économiques positifs, notamment des économies liées aux émissions de gaz à effet de serre et la création d’emplois. .
Néanmoins, 16 ans après sa conception, la GGWI continue de faire face à des défis de mise en œuvre critiques, notamment une mauvaise intégration de l’initiative dans les stratégies environnementales nationales, des structures et processus organisationnels faibles, une coordination insuffisante et des flux d’informations inadéquats aux niveaux régional et national. .
Ces problèmes non seulement empêchent l’initiative d’atteindre ses objectifs ultimes, mais risquent également de la rendre vulnérable à la corruption.
La GGWI doit être prête à résoudre ses problèmes de gouvernance et à mettre en œuvre des changements pour garantir que les fonds et les opportunités ne soient pas gaspillés.
Le GGWI présente une vision audacieuse et transformatrice pour relever les défis environnementaux et de développement. L’impact positif qu’une Grande Muraille Verte pleinement réalisée à travers le Sahel pourrait avoir sur la vie quotidienne des habitants de la région est monumental.
Toutefois, pour réaliser ses ambitions, elle doit être vigilante face aux risques de corruption et mettre en place des garde-fous significatifs.
La structure de gouvernance de la GGWI doit donner la priorité à l’inclusivité, à la transparence et à la responsabilité, permettant l’engagement actif des individus, des organisations de la société civile et des communautés locales dans l’élaboration et la conduite de l’initiative.
En abordant directement ces défis, la GGWI peut devenir une force puissante pour le développement durable dans la région du Sahel et au-delà.
Source transparency.org