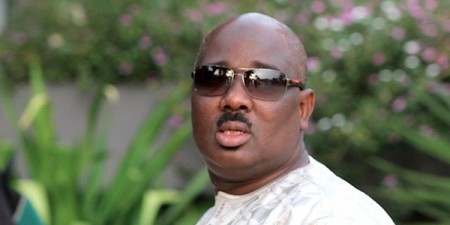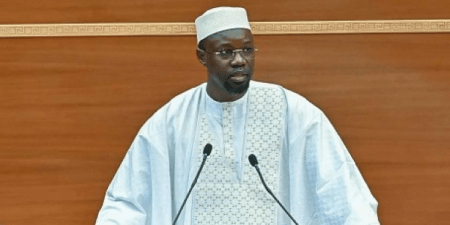Un nouveau rapport met en lumière les impacts positifs et négatifs, réels et potentiels, de l’industrie de la farine et de l’huile de poisson (en anglais, l’acronyme FMFO) sur les différents acteurs de la chaîne de valeur des petits poissons pélagiques au Sénégal.
Intitulée Track the fish ou (Suivre le Poisson, en français), l’étude menée par Partner Africa, conclut que l’expansion rapide de l’industrie de la farine et de l’huile de poisson menace les métiers de des femmes transformatrices, mais soulève également des inquiétudes quant à son impact négatif sur les écosystèmes marins, la surpêche et les conflits potentiels avec les pêcheurs artisanaux qui dépendent des petits poissons pélagiques pour leur subsistance
En effet, note le document parcouru, mercredi dernier, le Sénégal compte plus de 500 km de côtes et représente, avec les pays voisins du Maroc, de la Mauritanie et de la Gambie, l’un des points chauds pour les petits pélagiques dans le monde.
On indique que les volumes de produits de la pêche exportés sur la période 2008-2018 sont de l’ordre de 170 000 tonnes, en moyenne par an et représentent près de 38 % de la production nationale moyenne annuelle totale estimée à 451 000 tonnes. Sur les quantités de poisson exportées du Sénégal, les poissons congelés représentent 93% et le reste des produits (poissons frais, filets, poissons fumés ou salés, farines de poisson, etc.) représentent les 7 % restants.
Concernant la farine de poisson en particulier, une forte augmentation de quantités exportées est relevée entre 2012 et 2015, passant respectivement de 485 tonnes à 8300 tonnes. De plus, le rapport coche environ 4 usines FMFO au Sénégal, bien que, précise-t-il, le nombre exact d’usines en activité fluctue régulièrement.
En septembre 2022, rappelle-t-on dans la même source, un collectif de pêcheurs avait lancé une action judiciaire « historique » contre une usine FMFO au Sénégal pour violation de leur droit à un environnement propre. Même si l’affaire a été récemment rejetée, cela montre l’importance des griefs que les communautés voisines opposent à l’industrie, déclarent les auteurs du rapport.
Le droit à la sécurité alimentaire
D’après le document de Partner Africa, lorsque les petits pélagiques sont transformés par des entreprises artisanales (femmes transformatrices) et vendus sur les marchés locaux, ils constituent une riche source de protéines pour la population locale. Cela contribue au droit à la sécurité alimentaire, en garantissant l’accès à des aliments nutritifs.
Celui-ci mentionne que les petits pélagiques représentent une source de protéines importante pour les ménages sénégalais et représentent 82 % de la consommation totale de poisson dans le pays. C’est ainsi que sur la période 2009-2018, une moyenne de 315 000 tonnes de petits poissons pélagiques ont été débarquées chacune année (représentant 72% des captures).
La majeure partie est consommée à l’échelle nationale, frais, congelés ou transformés par la main, tandis que la transformation artisanale (fumage, séchage et salage) génère des revenus pour de nombreux ménages tout en contribuant à la sécurité alimentation.
Impact positif sur les moyens de subsistance et le droit au travail
Par ailleurs, Track the fish (Suivre le Poisson) souligne que l’industrie de transformation artisanale des petits poissons pélagiques peut avoir un impact positif sur les droits de l’homme des populations locales. Elle a créé un nombre important d’emplois directs et indirects (formels et informels) tout au long de la chaîne de valeur, stimulant diverses activités économiques connexes pour les populations et les communautés côtières.
Le rapport estime que les pêcheries pélagiques côtières artisanales emploient au total plus de 84.000 personnes : 12.000 pêcheurs, 34 000 emplois connexes dans le commerce du poisson et 38 000 dans le secteur de la transformation artisanale du poisson.
« Ce rapport souligne l’importance d’une gouvernance transparente et responsable des pêcheries de petits pélagiques et la nécessité de stopper l’expansion, voire de réduire les usines de farine et d’huile de poisson au Sénégal (…) afin de garantir la protection des écosystèmes marins et des droits des communautés locales à la protection de leurs emplois », a commenté Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne océans de Greenpeace Afrique.
Dans un communiqué reçu, il a rappelé que l’Organisation non gouvernementale a toujours soutenu que les métiers des communautés de pêcheurs, plus particulièrement des femmes transformatrices, devraient être protégés contre cette industrie « destructrice » de la farine de poisson afin d’éviter l’épuisement des stocks de poissons pouvant entraîner les communautés ouest africaine dans une insécurité alimentaire et une situation environnementale dommageable
Vox populi